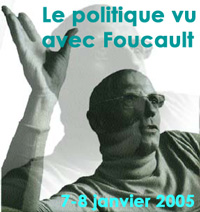
Colloque — "Le politique vu avec Foucault. Quelle est la fécondité des outils de Michel Foucault pour analyser le politique ?"
Paris, 7-8
janvier 2005
|
APPEL
A COMMUNICATIONS |
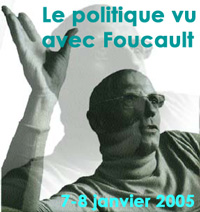 |
|
Dans le cadre d’un colloque organisé par l’A.F.S.P. (Association Française de Science Politique), le C.I.R. (Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales) et le C.R.E.D.E.P. (Université Paris IX — Dauphine), cet appel est lancé par :
Pascale LABORIER (C.U.R.A.P.P.),
Pierre LASCOUMES (C.E.V.I.P.O.F.),
Jean LECA (Président de l’A.F.S.P.),
Sylvain MEYET (Sciences po, C.E.V.I.P.O.F.),
Marie-Cécile NAVES (C.I.R., CREDEP) et
Thomas RIBEMONT (C.I.R., CREDEP).
Vingt ans après la disparition de Michel Foucault, son œuvre, à l’étranger comme en France, inspire bien des universitaires dans leurs recherches sur le fait politique. Des politistes appartenant à des champs d’étude comme la théorie politique, la politique comparée, les relations internationales et la sociologie politique — autour de la notion de gouvernementalité notamment — ont développé des analyses en partie redevables à Foucault. D’autres sciences sociales comme la sociologie, l’anthropologie ou l’histoire ont aussi puisé dans ses textes pour nourrir leur appréhension du politique. Enfin, des domaines transdisciplinaires — comme les études de genre ou les analyses liées au corps - se sont également intéressés à son œuvre.
Ce phénomène peut apparaître comme principalement anglo-saxon, et de fait les travaux en langue anglaise se multiplient depuis 20 ans. Pourtant, de plus en plus d’universitaires français utilisent explicitement Foucault dans leurs travaux sur le politique. Sans dresser de liste exhaustive, la mention de la tenue de deux colloques de science politique autour de son œuvre — l’un au CERI en 1997, et l’autre à Sciences-Po en 1999 — suggère que celle-ci sert désormais en France pour analyser le politique.
Parallèlement, et parfois en liaison avec ces usages universitaires, des militants utilisent ses actions ou ses textes comme sources d’inspiration, comme points de repère, comme références ou comme outils politiques pour leurs réflexions et leurs actions. Ces usages militants sont eux aussi divers, allant de groupes critiquant le capitalisme à d’autres réformistes, et parcourant l’ensemble du spectre, de la filiation intellectuelle déclarée au sous-entendu, en passant par l’usage critique et/ou mélangé.
Ce colloque ne prétend certes pas vouloir dresser un bilan de l’ensemble de ces utilisations. Nous n’estimons surplomber ni le destin de l’œuvre, ni ses postérités. Pourtant, cinquante ans après les premières analyses de Michel Foucault et vingt ans après les dernières, nous voulons nous interroger sur la place de cette œuvre dans l’intelligence de notre actualité et dresser un état des travaux réalisés.
Du côté universitaire, quels types de démarche révèlent ces travaux (par exemple, influence, rencontre, convergence, libre appropriation, prétexte) ? Quelles évolutions ont-ils connues ? A quels débats ont-ils pris part, et quelles problématiques ont-ils suscitées ? Ont-ils ouvert de nouvelles perspectives, de nouveaux objets, de nouveaux champs d’études ? Comment se situent-ils au sein de leurs disciplines ? Comment et dans quelles conditions pouvons-nous aujourd’hui considérer l’œuvre de Foucault comme pertinente pour l’étude du politique ?
Du côté militant, qu’ont réalisé les groupes qui s’en sont inspirés ? De quelle manière a-t-elle influencé leurs pratiques ? A-t-elle initié de nouvelles orientations de l’action ? Quelles places occupent ces groupes dans le paysage du militantisme ?
Nous ne proposons donc pas de distinguer de bonnes et mauvaises utilisations de Foucault en fonction de leur fidélité à l’œuvre. Nous suggérons de retracer les parcours de ces utilisations, afin de débattre des travaux auxquels elles ont donné lieu et des résultats auxquels elles sont parvenues. Cette posture n’exclut toutefois en rien l’examen des textes mêmes de Foucault dans une perspective d’emploi. En bref, nous suggérons que dresser un " état de l’art " des usages de l’œuvre de Foucault pourrait nous permettre d’apprécier leur portée actuelle.
Dans cette optique, les propositions traitant des thèmes suivants recevront une attention particulière. Toutefois, nous recevrons avec plaisir tout autre type de proposition :
Le colloque se déroulera les 7 et 8 janvier 2005 à Sciences po et au C.I.R.
Le comité d’organisation est composé de Pascale LABORIER (C.U.R.A.P.P.), Pierre LASCOUMES (C.E.V.I.P.O.F.), Jean LECA (Président de l’A.F.S.P.), Sylvain MEYET (Sciences po, C.E.V.I.P.O.F.), Marie-Cécile NAVES (C.I.R., C.R.E.D.E.P.) et Thomas RIBEMONT (C.I.R., C.R.E.D.E.P.).
Le comité scientifique est composé de John CROWLEY (U.N.E.S.C.O., C.I.R.), Yves DELOYE (I.E.P. Strasbourg), Jean-Marie DONEGANI (C.E.V.I.P.O.F.), Eric FASSIN (E.N.S.), Brigitte GAITI (Université Paris IX), Frédéric GROS (Université Paris XII), Pascale LABORIER (C.U.R.A.P.P.), Pierre LASCOUMES (C.E.V.I.P.O.F.), Jean LECA (Président de l’A.F.S.P.), Daniel MOUCHARD (Université de Poitiers, C.I.R.), Gérard NOIRIEL (E.H.E.S.S.).
Les propositions de communication peuvent couvrir tous les aspects des usages universitaires et militants de l’œuvre de Michel Foucault traitant du politique. Toutefois, celles qui aborderont l’un des thèmes présentés ci-dessus seront privilégiées. De plus, les propositions devront développer des réflexions originales et n’avoir jamais fait l’objet d’une publication. Les auteurs pourront par ailleurs être sollicités en vue d’une publication collective, et il leur est par conséquent demandé de ne pas proposer leur communication en vue d’une publication avant le colloque.
Les propositions de communication ne devront pas dépasser 500 mots et elles devront être accompagnées du nom de leur(s) auteur(s), ainsi que des affiliations professionnelles et des coordonnées de ce(s) dernier(s).
Toutes les propositions seront examinées par le comité scientifique, qui statuera sur leur pertinence et leur qualité.
Les propositions sont à envoyer avant le 1er août 2004 à l’adresse suivante : sylvain.meyet@sciences-po.org.
Pour les propositions acceptées, le texte des communications sera à remettre avant le 10 décembre 2004.