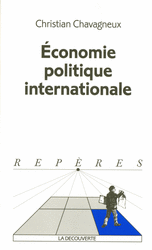
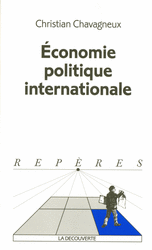 |
Christian CHAVAGNEUX, Économie politique internationale, Paris, La Découverte, 2004 (Repères, n°367)
Qui détient le pouvoir dans l’économie mondiale ? Telle est la question principale des spécialistes de l’économie politique internationale, à laquelle ni les économistes ni les spécialistes de sciences politiques ne répondent vraiment. L’économie politique internationale, elle, s’intéresse à des questions d’une actualité brûlante : comment s’exerce la domination des États-Unis ? Les marchés financiers imposent-ils leur loi ? Quel est le pouvoir des entreprises multinationales ? Du Fonds monétaire international ? Des mafias ? Les mouvements sociaux internationaux vont-t-ils changer le monde ? Trois écoles de pensées, analysées ici en détails, se partagent les débats. La première défend l’idée que les États restent les principaux acteurs du système international. La deuxième privilégie une analyse fondée sur la montée en puissance d’une classe dirigeante transnationale. La troisième met l’accent sur le rôle politique des acteurs non étatiques (multinationales, banquiers, bandits…). Largement implantée dans les universités anglo-saxonnes, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, au Japon, etc., l’économie politique internationale reste peu connue en France. Cet ouvrage comble cette lacune.
Table des matières
Introduction - Les trois réponses de l’EPI - Encadré : D’où vient l’économie politique internationale ? - I / Les États, rien que les États - À la base : l’" école réaliste " - Les fondements - Le pouvoir relationnel - Stabilité et guerres hégémoniques - Le libéralisme contre l’hégémonie - La théorie des régimes - Une critique des régimes - Le soft power - Une EPI en voie d’extinction ? - Encadrés : Les différentes formes de pouvoir — Des travaux de plus en plus abstraits - II / La diffusion du pouvoir et la non-gouvernance - Le pouvoir structurel - La structure de sécurité - La structure de production - Le triangle des marchandages - La structure financière - FMI et BRI inadaptés - La structure des savoirs - Une méthode de diagnostic - Le refus des grandes théories - Les cinq conclusions politiques - L’hégémonie de l’Empire américain - La montée en puissance des acteurs privés ; Les acteurs économiques - Le poids des cartels - La loi internationale au service des intérêts privés ; Les ONG ; Les acteurs illicites - Des zones de non-gouvernance - Pas de complot mondial - Une vision pessimiste mais qui reste motivée par la critique de l’ordre établi - Encadré : Susan Strange et ses âmes sœurs - III / La mondialisation des classes dominantes - Le triptyque de base : production, État, ordre mondial - La production - L’État - L’ordre mondial - L’ordre mondial néolibéral : de 1945 à nos jours… - L’internationalisation de la production - L’internationalisation de l’État - La projection de l’hégémonie américaine - La remise en cause de l’ordre libéral - Apports et critiques - Quelques faiblesses de l’approche - Encadrés : Les origines de l’approche — Une théorie critique - Conclusion - L’EPI en France : l’état du débat - L’EPI et les économistes français - L’école de la régulation et les régimes - Le régime international des régulationnistes - Pas de régime - Enseigner l’EPI - Repères bibliographiques.