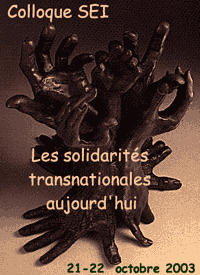
Bilan du 3ème colloque international
Par Josepha Laroche.
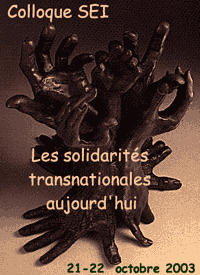 |
Bilan du 3ème colloque international Par Josepha Laroche. |
Le colloque de la SEI sur les solidarités transnationales qui s’est tenu les 21 et 22 octobre 2003 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a réuni un nombre important de chercheurs et doctorants, donnant ainsi lieu à de riches débats.
Guillaume Devin, professeur à l’IEP de Paris et responsable scientifique, a invité d’emblée les contributeurs du colloque à analyser la structuration des phénomènes actuels de solidarité à l’échelle mondiale dans une perspective évolutionnelle, au sens de Norbert Elias. Pour ce faire, reprenant l’hypothèse de Durkheim suivant laquelle " densité matérielle " et " densité morale " vont de paire, il a proposé que les travaux des participants s’efforcent tout au long du colloque de vérifier l’hypothèse suivante : les solidarités se sont individualisées à l’échelle internationale à mesure que les sociétés se sont resserrées.
Après avoir rappelé que le terme " solidarité " était d’origine juridique, les participants ont défini la solidarité dès le début du colloque comme une relation d’entraide entre acteurs, un fait social qui renvoie à des formes d’action sociale s’inscrivant dans la durée : la solidarité ne saurait donc être appréhendée comme un phénomène a-temporel. Autrement dit, il apparaît indispensable de contextualiser, d’historiciser toutes les recherches sur les solidarités, de mettre en perspective leurs modalités d’intervention sur la scène mondiale afin de pouvoir mieux rendre compte des conditions sociales d’émergence des solidarités transnationales actuelles et donc de prendre en compte l’intervention des nouveaux acteurs, désormais parties prenantes de ce processus.
Aujourd’hui, force est de constater que :
Un processus d’individualisation plus accentué
Modalités de circulation de la solidarité
Plus la transnationalisation des solidarités s’opère facilement, plus la dialectique et la dynamique homogénéité/hétérogéneité se met en place par une valorisation simultanée des échelons local et mondial. Avec bien souvent l’échelon national qui se trouve court-circuité, notamment grâce au " bricolage " d’une nouvelle identité, celle de " citoyen du monde ".
Composante organisationnelle
Le colloque a fait apparaître qu’il existait des phénomènes des solidarités intra-organisationnelles (Greenpeace) mais aussi de concentration organisationnelle et de coalition organisationnelle (exemple de VOICE) avec des campagnes de solidarité de plus en plus globalisées. De même, il existe à présent des formes d’expression de solidarités transnationales inter-organisationnelles, notamment dans le cadre de l’altermondialisation.
Processus d’intégration
Pour analyser la structuration des solidarités à l’échelle mondiale, il convenait de se pencher sur la coopération, les coordinations, les articulations qui existent entre les différents acteurs des solidarités transnationales (États, firmes, O.I, ONG, individus, groupes).
Mixité des modalités de construction des solidarités
L’ensemble des contributions a mis l’accent sur les " mixtes " privé/public (ex : États/ONG ; États/firmes ; ONG/O.I., firmes/O.I.), micro/macro politiques, local/mondial par lesquels s’expriment et se construisent les solidarités transnationales aujourd’hui.
Chaînes de la solidarité
Plus le mouvement de transnationalisation des solidarités s’opère sans heurts, plus les chaînes de solidarité sont amples et bénéficient de relais nombreux et plus la solidarité est perçue comme légitime. Au contraire, plus les chaînes de solidarités sont courtes, contestées, clandestines et moins il y a de coopération.
Les travaux du colloque concluent à la nécessité d’entreprendre une sociogenèse des solidarités transnationales. En l’occurrence, il s’agirait de faire le plus grand cas du fait qu’elles se déploient désormais dans le cadre de la mondialisation de l’économie de marché.