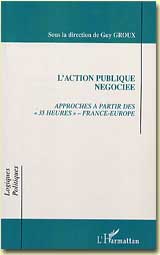
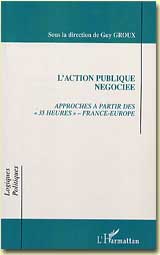 |
Guy
Groux (dir.)
|
Dans de nombreux
pays européens, la question de la durée du travail s’est
posée parfois avec insistance ; c’est le cas notamment de
l’Allemagne, de l’Italie et de certains pays d’Europe
du Nord. Pourtant, c’est en France que la durée du travail
a fait l’objet d’une prise en charge légale et contractuelle
aussi massive. Persistance de "l’exception française" ou
simple effet d’une conjoncture politique liée au retour
de la gauche au pouvoir en 1997 ? De telles questions impliquent tout
d’abord l’approche de divers domaines, que ceux-ci concernent
la France ou d’autres pays voisins. Il en est ainsi de la place
du thème de la durée du travail dans l’histoire des
mouvements sociaux ; de sa présence dans le débat politique
; de sa traduction dans l’opinion.
Par-delà l’analyse de ces divers contextes, d’autres
approches s’imposent, qui relèvent des enjeux contractuels,
institutionnels et juridiques liés aux "35 heures". Ce qui est
en cause ici, ce sont bien de nouvelles modalités de l’action
publique. La durée du travail ne constitue pas une revendication
ordinaire. Dans le domaine contractuel, elle implique un rapport inédit
entre la loi, l’action publique et la négociation. Cette
dernière n’agit plus seulement afin de matérialiser
l’initiative publique, comme c’était souvent le cas
dans le passé. Elle ne se situe plus seulement en fonction de
décisions politiques ou juridiques prises "hors d’elle".
Elle a aussi pour rôle de refaçonner l’initiative
du législateur voire de réviser certains des postulats
sociaux ou économiques liés aux "intentions initiales"
du pouvoir politique. La négociation collective joue ainsi un
rôle plus patent dans les processsus de l’action publique
qui s’appliquent à l’entreprise, au marché du
travail, à la définition des normes et des règles,
aux temps sociaux, à l’action collective, etc… Au total,
autant de domaines qui par leur diversité même exigent
une approche fondée sur des disciplines distinctes : l’économie,
la sociologie, l’histoire, la science politique ou le droit.
Table des matières
Guy Groux, La durée du travail. De l’enjeu économique aux enjeux de connaissance. Introduction
Première partie : Une mise en perspective historique et politique
Deuxième partie : L’Union européenne. Éléments de comparaison
Troisième partie : Accords conclus et études de cas
Quatrième partie : Vers une action publique négociée ?
Guy Groux, L’action publique négociée ou l’institutionnalisation des conflits de règles ? Propos de conclusion
Les auteurs
ANGELOFF Tania,
maître de conférences en sociologie, Université
Paris 9, Dauphine.
BARISI Giusto, socio-économiste, ISERES.
BOISARD Pierre, adjoint au directeur du Centre d’études
de l’emploi.
BOULIN Jean-Yves, chercheur au CNRS/IRIS.
CHICHE Jean, ingénieur de recherches au CNRS-CEVIPOF.
Freyssinet Jacques, professeur d’économie à l’Université
de Paris I, directeur de l’IRES (Institut de Recherches Économiques
et Sociales).
GALAMBAUD Bernard, professeur à l’Ecole supérieure
de commerce de Paris (ESCP-EAP), directeur d’études à
l’Institut Entreprise et Personnel.
GROUX Guy, directeur de recherche au CNRS, fondateur avec Pierre Muller
du pôle "Action publique" au sein du CEVIPOF.
HAEGEL Florence, chargée de recherches au CEVIPOF.
JAVILLIER Jean-Claude, directeur du Département des Normes Internationales
du Travail, Bureau International du Travail, Genève, C.H.
JEFFERYS Steve, professeur de relations industrielles, University of
North London, Royaume-Uni.
LALLEMENT Michel, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers
(Paris), Chaire d’analyse sociologique du travail, de l’emploi
et des organisations.
Lascoumes Pierre, directeur de recherche au CNRS-CEVIPOF.
LE GALL du TERTRE Christian, professeur de sciences économiques
à l’Université Lille 1, directeur-adjoint de l’IRIS-CNRS-Université
Paris-Dauphine.
REYNAUD Jean-Daniel, professeur honoraire de sociologie du travail et
des relations professionnelles au Conservatoire National des Arts et
Métiers (Paris), co-fondateur de la revue Sociologie du travail.
ROBERT Jean-Louis, professeur à l’Université Paris
I, directeur du Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle.
ROUBAN Luc, directeur de recherche au CNRS-CEVIPOF.
THOEMMES Jens, chargé de recherches au CNRS (Centre de Recherches
: Techniques, Organisation et Pouvoir, CERTOP, Toulouse).