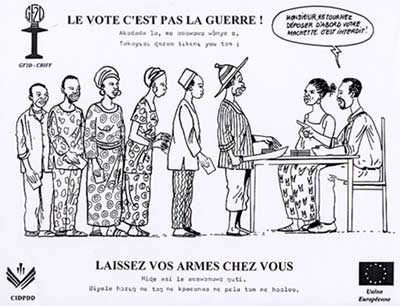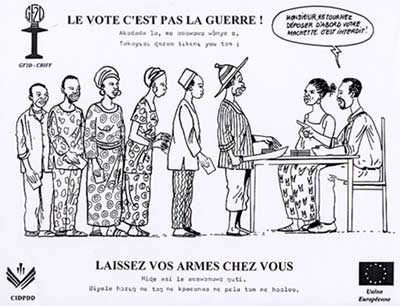 |
Voter
en Afrique : différenciations
et comparaisons
7-8 mars 2002
Colloque
organisé par l’AFSP
sous la direction de
Patrick Quantin (FNSP-CEAN)
Institut
d’études politiques de Bordeaux
11,
avenue Ausone
BP101
33607 Pessac Cedex
|
Comment
les politologues travaillant sur l’Afrique peuvent-ils contribuer
aux débats de la science politique "générale" ?
Cette dernière, science politique de référence,
parce qu’elle définit le cadre d’une discipline, est
aussi perçue comme "centrale" puisqu’elle se consacre d’abord
et surtout aux sociétés occidentales par opposition aux
études d’"aires" situées à la périphérie
du monde.
Les
recherches sur le politique en Afrique peuvent-elles se tenir à
l’écart des discussions sur les théories et les méthodes
autour desquelles s’est construite et évolue la science
politique "centrale" ? Doivent-elles se désintéresser
des thèmes plus classiques que sont les objets politiques déjà
identifiés : partis, bureaucratie, institutions, politiques
publiques, mobilisation, participation, élites, élections,
etc. ?
Il
s’agit, au cours de ce colloque de l’Association française
de science politique, de poser ces questions. Le thème des élections
a été retenu car il offre des possibilités de convergence
entre "africanistes", comparatistes et, bien sûr, "électoralistes".
Il propose d’observer les différences et de formuler un
comparatisme qui n’irait pas du centre vers la périphérie,
qui n’interrogerait pas l’autre en fonction de soi mais au
contraire tirerait profit du regard éloigné et se libérerait
des pesanteurs de l’exotisme.
A
première vue, la différence entre les scrutins africains,
organisés dans des sociétés en développement
aux systèmes politiques instables, et ceux des démocraties
occidentales relève de l’évidence. Pourtant, cette
distinction appelle un retour sur les conditions scientifiques qui ont
présidé à la coupure entre systèmes politiques
occidentaux et africains. En effet, si elle a souvent rendu compte des
événements électoraux, la recherche africaniste
sur le politique s’est peu intéressée à l’élaboration
d’une problématique générale visant à
expliquer ce que voter veut dire ou encore ce qu’est une consultation
électorale dans les sociétés africaines contemporaines.
Pourtant,
les présupposés qui fondent la séparation entre
élections "occidentales" et élections africaines sont
discutables. Certes, les critères de compétitivité
définissent tendanciellement une distinction, mais tous les systèmes
européens ne sont pas concurrentiels (ou pour le moins ne l’ont
pas toujours été) tandis que l’Afrique a connu des
expériences d’élections libres à différentes
périodes. Ces critères sont insuffisants pour justifier
une coupure.
Comme
ailleurs dans le monde, pour comprendre les électeurs africains
(et l’acte de vote), il faut comprendre les élections (comme
cadre variable de l’action) ; et pour comprendre les élections
compétitives, il faut auparavant s’interroger et expliquer
les mécanismes des élections classées non-compétitives,
situations dans lesquelles la lutte pour le pouvoir se joue ailleurs
que dans les urnes. La dimension historique a ici son importance :
elle affaiblit la thèse d’une importation de la démocratie
et de ses procédures. Elle nuance l’hypothèse du
mimétisme. Le problème de comparaison qui est posé
intéresse non seulement les sociétés au sud du
Sahara mais aussi la problématique générale de
la démocratie.
On
a tendance à n’écrire aujourd’hui sur les élections
en Afrique que pour en démasquer les imperfections et dénoncer
les inadaptations. Pourtant, il ne suffit pas de déplorer que
la voie électorale n’est pas une pente naturelle des systèmes
politiques africains et il est extrêmement aisé de trouver
des arguments pour montrer qu’elle engendre autant de problèmes
immédiats qu’elle peut en résoudre.
Pour
disposer d’une série d’observations suffisamment variées,
effectuées dans la durée, il convient de se référer
à l’histoire des expériences électorales de
ces cinquante dernières années en Afrique et non pas seulement
aux seuls scrutins des années 1990. Cette perspective met en
évidence des décalages et des dysfonctionnements par rapport
aux résultats attendus. Ces apparentes "anomalies" peuvent être
regroupées en trois grandes catégories. D’abord,
celles qui décèlent l’absence de discipline ou d’intériorisation
des normes de "bonne conduite" et qui posent le problème en termes
de non-institutionnalisation de la loyauté politique. Ensuite,
celles qui touchent aux difficultés de l’organisation de
la mobilisation partisane et qui déplorent l’absence d’une
scène politique autonome. Enfin, il est nécessaire de
distinguer les caractéristiques touchant plus précisément
la production des représentations et des choix. C’est l’occasion
de souligner combien le vote est lié à l’individualisation
des préférences, ce qui n’exclue pas nécessairement
des dimensions communautaires dans la construction des préférences.
S’agirait-il
d’élections structurellement et définitivement "pas
comme les autres" ? Un nouvel examen porte la critique à
deux niveaux bien différents.
D’abord,
les systèmes politiques qui - hors d’Afrique - recourent
aujourd’hui avec succès à la démocratie électorale
présentaient un tableau tout aussi incertain durant la phase
d’institutionnalisation de ce modèle. Avant de parvenir
à réguler à la fois la circulation des élites
politiques et la communication entre ces élites et le reste de
la population, ils ont traversé de longues périodes durant
lesquelles ni les structures, ni les acteurs n’étaient adaptés
au fonctionnement d’élections pluralistes, "libres et honnêtes"
organisées régulièrement.
Ensuite,
il convient de dépasser ce nécessaire rappel pour se dégager
d’une approche développementaliste. En effet, ce n’est
pas seulement l’imperfection des pratiques électorales dans
la genèse des régimes démocratiques pluralistes
qu’il convient de mettre en avant pour saisir l’incertitude
des trajectoires africaines contemporaines. Il est aussi très
important de montrer, ou de rappeler, que ces imperfections sont des
éléments constitutifs permanents du fonctionnement des
démocraties électorales occidentales et des régimes
apparentés. Aucune de ces expériences, en commençant
par les plus souvent citées en exemple - anglaise, américaine
ou française - ne fonctionne aujourd’hui sans équivoque,
sans atteintes aux normes de la loyauté politique, sans flottement
dans la mobilisation partisane et sans interférence identitaire
remettant en cause l’individualisation du vote. En un mot, l’institutionnalisation
incertaine de la démocratie électorale en Afrique doit
être lue à la lumière des échecs et des hésitations
des expériences confirmées dans les sociétés
porteuses du modèle afin de relativiser les diagnostics. Cette
lecture peut s’organiser autour de la discussion d’hypothèses
qui remettent en question la particularité structurelle du vote
dans les sociétés africaines sans pour autant négliger
la singularité des trajectoires politiques de chacune.
Face
à la (re)démocratisation en Afrique, la recherche universitaire
semble avoir été prise au dépourvu par les plans
élaborés dans les circuits de la politique internationale.
La Banque Mondiale a lancé le mot d’ordre de la "good governance"
dans son rapport annuel de 1989, la France a renchéri par le
discours de La Baule de 1990 liant l’aide à la réforme
politique et les Etats-Unis comme la Communauté Européenne
ont rivalisé de sévérité dans l’application
de critères de "conditionnalité démocratique" des
systèmes politiques africains. Même si par la suite, la
pression a quelque peu diminué, laissant de nouveau le pragmatisme
s’exprimer, il est encore difficile d’aborder d’un point
de vue non normatif le problème des élections en Afrique.
Or, l’enjeu scientifique actuel est d’interpréter les
processus mis en jeu dans le passage à la démocratie électorale,
autant ceux qui facilitent ce passage que ceux qui le contrarient car
ils fournissent des indications sur les capacités de changement
des systèmes politiques. Ceci suppose la mise en place d’un
dispositif - théorique et pratique - adapté à l’observation
du vote et à l’ensemble des mécanismes sociaux qui
le déterminent. Cette carence est patente comparée aux
moyens affectés à cette tâche dans des sociétés
où la démocratie est stabilisée et où les
études électorales disposent d’un luxe de raffinements.
La différence entre le vote en Afrique et en Occident est autant
dans le regard qui est porté par les chercheurs que dans la culture
politique des électeurs.
Ces
quelques orientations indiquent que la problématique de la comparaison
des élections africaines, aussi bien entre elles qu’avec
celles qui ont lieu ailleurs dans le monde, doit rejeter le programme
du "commentaire politique" qui reste centré sur les résultats.
Elle doit au contraire proposer des approches qui contournent le comptage
de voix pour mettre au jour les mécanismes d’un phénomène
social total. La grille présentée ici s’attache à
ce programme.
PROGRAMME
7 mars 2002
09.00 – 09.30
: Accueil
09.30 – 10.00
: Ouverture :
- Jean LECA, Président de l’AFSP*
- Robert LAFORE, Directeur de l’IEP
de Bordeaux
- Dominique DARBON, Directeur du CEAN
10.00 – 12.30
Introduction générale
Président
: P. SADRAN (IEP Bordeaux)
Discutant : D.L. SEILER (IEP,
Bordeaux), Alice SINDZINGRE (CNRS Paris)
QUANTIN, Patrick (CEAN, Bordeaux)
Un objet politique déjà identifié : le
vote en Afrique
Télécharger
le texte (format pdf 53 Kb)…
BAKARY, Tessi (Université Laval)
Élections et démocratisation en Afrique : tentative
de bilan
VAN de WALLE, Nicolas (Michigan State
University)
Presidentialism and Clientelism in Africa’s Emerging
Party Systems
Télécharger
le texte (format pdf 55 Kb)…
SINDJOUN, Luc (Université de Yaoundé
II)
Qu’est qu’une élection "libre et honnête"
au Cameroun ?
14.30 – 18.00
Président
: F. CONSTANTIN (CREPAO, Pau et pays de l’Adour)
Discutant : Nonna MAYER (CEVIPOF,
Paris), OTAYEK, René (CEAN, IEP Bordeaux)
GAZIBO, Mamoudou (Université de
Montréal)
La vertu des procédures : vote et transformation des
comportements politiques au Niger
Télécharger
le texte (format pdf 165 Kb)…
TONDA, Joseph (Université O. Bongo,
Libreville)
Le paradoxe du "leader esclave" en Afrique centrale
Télécharger le
texte (format pdf 55 Kb)…
MAYRARGUE, Cédric (CEAN, IEP Bordeaux)
Les représentations et les comportements des acteurs
politiques en campagne électorale. Une étude
des tracts et des meetings au Bénin.
Télécharger
le texte (format pdf 70 Kb)…
TOULABOR, Comi (CEAN, IEP Bordeaux)
Les élections des années 1950 au Togo, mobilisation
partisane et apprentissage du vote
Télécharger
le texte (format pdf 38 Kb)…
8 mars 2002
09h00 – 12h30
Président
: Jean-François BAYART (CERI)
discutant : Ch. COULON (IEP Bordeaux)
COMPAGNON, Daniel (CEAN, IEP Bordeaux)
La pertinence de la phase préparatoire des opérations
de vote dans l’analyse de la signification du processus
électoral en Afrique (Zimbabwe, Botswana)
Télécharger
le texte (format pdf 37 Kb)…
PEROUSE de MONTCLOS, Marc-Antoine (IRD,
Paris) :
Mais où sont passés les syndicats ? des déficiences
structurelles à l’épreuve de la démocratisation
en Afrique
Télécharger
le texte (format pdf 48 Kb)…
MAINDO,
Alphonse (Paris I)
Kisangani/RDCongo en 1997 : de l'appropriation du processus
électoral par "le bas" à la revanche
populaire
Télécharger
le texte (format pdf 72 Kb)…
ATLAN,
Catherine (Aix)
Fraudes et violences électorales (1900-1940) : genèse
d'une tradition politique à l'époque coloniale
14.30 –
18.00
Président:
Pierre Muller
Discutants : Richard BALME (IEP Paris- CEVIPOF),
Christophe JAFFRELOT (CERI)
MESSIANT, Christine (CEA, EHESS, Paris)
Angola
"mobilisations
électorales, mobilisations guerrières (1992
et 2002)"
THIRIOT, Céline, (CEAN, IEP Bordeaux)
Les enjeux matériels de l’élection
BANEGAS, Richard (Paris I)
Vote et marchandisation (Bénin)
ENGUELEGUELE, Maurice (Université
d’Amiens)
Le paradigme de l’analyse économique du vote en
Afrique: le cas du Cameroun
Télécharger
le texte (format pdf 105 Kb)…
OULD AHMED, Zekeria (Nouakchott)*
Gouverner les élections : l’Observatoire National
des Elections (ONEL) au Sénégal
Télécharger
le texte (format pdf 103 Kb)…
* (sous réserve)