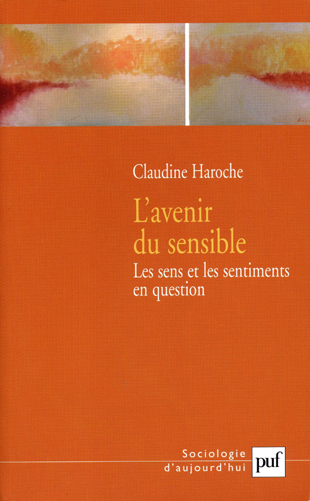 Claudine
Haroche, L'avenir du sensible, les sens et les sentiments en question,
Paris, PUF, 2007
Claudine
Haroche, L'avenir du sensible, les sens et les sentiments en question,
Paris, PUF, 2007 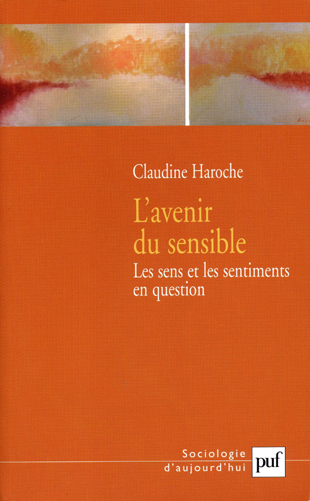 Claudine
Haroche, L'avenir du sensible, les sens et les sentiments en question,
Paris, PUF, 2007
Claudine
Haroche, L'avenir du sensible, les sens et les sentiments en question,
Paris, PUF, 2007
La
modernité occidentale a construit l'homme sensible et a lentement façonné
les sens et les sentiments.
Elle a placé au cœur de la condition humaine, en particulier depuis
les traités de civilité de la Renaissance, des exigences de retenue
du corps, de distance à autrui, délimitant ainsi un intérieur
et un extérieur en chacun. Elle a voulu inscrire l'individu dans un sentiment
de continuité, privilégier la perception d'une stabilité
de l'existence sur quoi se fonde la propriété de soi. Celle-ci
est aujourd'hui menacée par la fluidité d'un monde devenu immatériel,
dépourvu de limites.
Ce livre entreprend d'élucider les métamorphoses de la condition
sensible dans les sociétés contemporaines. Les flux sensoriels
et informationnels continus incitent l'individu à des formes de propriété
illimitée de soi en même temps qu'ils induisent un rétrécissement
de l'espace intérieur. Processus paradoxaux, ils transforment en profondeur
nos manières de sentir, de percevoir, d'être et de penser.
Cet état de fluidité entraîne des formes d'indistinction,
d'indifférenciation entre le réel et le virtuel, entre les individus,
reposant alors de façon aiguë la question du sens et des sens :
sommes-nous entrés dans une ère nouvelle de la condition sensible
?
Lecture par Olgaria Matos, Professeur à l’USP ( Sao Paulo)
L’avenir du sensible de Claudine Haroche traite de l’une des questions les plus cruciales de la contemporanéité: le vécu, le ressenti, l’éprouvé, le sensible dans les sociétés de masse, de consommation et de spectacle. Claudine Haroche a su synthétiser et théoriser d’une façon profondément éclairante le caractère fragmenté et discontinu de l’expérience vécue. Elle montre en effet que la question des manières de se conduire, de percevoir, de sentir et de penser, exige une réflexion sur le rapport au temps dans la civilisation industrielle et post-industrielle : elle insiste en particulier sur son incidence sur les liens traditionnellement structurés dans le long terme : l’amitié, l’amour, les liens familiaux, sociaux de manière générale, l’engagement, la promesse.
De Bergson à Elias, de Tocqueville à la pensée politique la plus actuelle, Claudine Haroche interroge, en les approndissant, les problèmes qui sont au cœur des démocraties aux prises avec l’économie de marché. L’avenir du sensible retrace ainsi la généalogie des catégories de sujet et d’individu dans la tradition occidentale du XVIème siècle au contemporain, évitant tant sa psychologisation que sa réduction au social. Ce sont à l’inverse les rapports complexes entre le politique et le social, le culturel et l’ économique leurs effets sur la subjectivité face aux métamorphoses anthropologiques induites par une " montée de l’ insignifiance ", une banalisation du mal, renforçant l’effacement de la culpabilité, la dissolution des " manières " et des formes jusqu’ alors à l’oeuvre au plus profond de la " vie bonne ".En se reférant de façon explicite à Zygmunt Bauman et à son concept de " liquide ", l’auteur entreprnde de rendre compte de l’émergence dans l’individu, de manières inédites de sentir.
Tout au long de l’ humanisme civique l’individu était en effet caractérisé par des exigences de modération et des règles de déférence reflétant un sujet de la connaissance, garant de valeurs tenues pour universelles.
La société pouvait ainsi se constituer au travers de ces médiations symboliques de façon à mantenir les frontières et les registres propres à l’ intimité, à la sphère privée et à la sphère publique. L’efficacité de ces dispositifs se révélait dans un " gouvernement de soi ", fondement du gouvernement politique. Enoncée une première fois en Grèce, reprise à la Renaissance jusqu’aux Lumières, cette tradition a soutenu l’impératif d’un gouvernement de soi comme condition préalable et essentielle d’un gouvernement de tous et de chacun.
Claudine Haroche avec une force et une rigueur impressionnante en rappelle les moments essentiels : la politisation du familial et la familialisation du politique, prenant l’exemple de rituels dans la société de Cour et leur devenir dans des sociétés démocratiques modernes à partir de la fin du XIXème siècle. Ce dont l’auteur rend bien compte c’est de l’effacement des médiations entre les individus, quand se diluent les espaces et les distances qui les instauraient, les structuraient en brouillant les cartes du jeu de la civilité et de la grammaire des gestes des individualités, de sorte à subvertir la possibilité même d’être un sujet, ce qui va de pair avec l’ascension triomphale de l’ individualisme et de l’informel. Le sujet se caractérise désormais par l’effacement des distances entre les individus en même temps que la dilution de la considération, qui relève en profondeur de la question de l’attention, ce qui a pour conséquence ce que Richard Sennett a désigné par l’idée d’effondrement de l’espace public.
L’ouvrage entreprend alors de développer un ensemble d’analyses portant sur l’ avènement d’individus désaffectés, l’autre versant de l’inégalité, des différentes figures de l’ injustice et de l’indifférence, attestés par le dépérissement de la catégorie éthique du respect et conduisant inéluctablement à l’humiliation dans la sphère publique . Ainsi se conclut le processus qui fait de l’homme un être superflu, en pleine montée de l’insignifiance et d’ entropie sociale. L’auteur en examine alors les conséquences : plus les individus sont incités à exposer leur vie intime et privée, plus ils sont dépossédés de vie intérieure et d’expériences partagées. La tyrannie de la visibilité dans le monde contemporain affaiblit les registres propres au voir et au sentir en nous approchant de ce qu’ Hannah Arendt a aperçu dans le condition de paria–un sentiment de non appartenance au monde, celui d’ être en trop et superflu.Ce qui revient à dire qu l’ individualité n’ a plus rien à quoi se tenir sauf elle-même . Claudine Haroche en tire alors pleinement les conséquences : l’inattention, le rétrécissement de la conscience et le déficit de symbolisation, de ritualisation des sentiments ramenés à la condition de sensations, réduisant alors les individus de plus en plus à l’ordre du corps passif auquel il n’est reconnu que le sens du divertissement, de l’assourdissement et de son isolement.
La diminution progressive de l’activité de la conscience se double d’un changement dans le registre de la pensée et c’est là que se loge la transformation antrhopologique du sujet dans la modernité. Claudine Haroche part dans ses réflexions des analyses de Bergson sur les catégories d’espace et de temps qui deviennent abstraites : vidées de l’ expérience vécue d une part, et du soutien de la pensée existentielle de l’autre, ces observations révèlent une perte fondamentale de répères symboliques où le sujet trouvait à s’inscrire ; d’où la fluidité générale, accélérée et illimitée semblant progressivement nous condamner à l’ordre du corporel réduit à la simple sensorialité et à un désordre grandissant.
Ce qui est donc mis en question au travers des sens et des sentiments c’est la gouvernance même dans les démocraties contemporaines, et ce au moment où les régulations de l’espace social se sont autonomisées de celles du sujet.
Il s’agit là on l’aura compris d’une réflexion majeure sur les évolutions contemporaines.