Pierre Bréchon, Bruno Duriez et Jacques Ion (dir.)
– Religion et action dans l’espace public –
Paris, L’Harmattan, 2000. 301 p. 21 cm. (Logiques politiques)
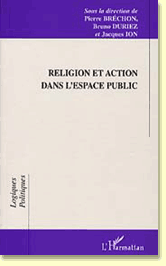
Les religions s'expriment aujourd'hui ouvertement dans l'espace public. En France, des personnalités religieuses occupent la scène médiatique, des manifestations religieuses deviennent des événements publics, des groupes qui mêlent visées religieuses et sociales se développent. Mais, dans le même temps, on observe un flottement grandissant des appartenances et des identités religieuses et une individualisation des croyances et des pratiques. De ce fait, les modèles religieux d'implication dans l'action publique deviennent plus incertains.
Quelles stratégies de retrait, d'attestation ou de contestation du monde les groupements religieux mettent-ils sur pied ? Choisissent-ils la visibilité ou la discrétion ? Quels liens peut-on établir entre la socialisation religieuse des individus et les formes de leur action publique, qu'il s'agisse de l'engagement politique, syndical, caritatif, humanitaire ou culturel, de l'action ponctuelle de protestation sociale, ou de manières d'être plus quotidiennes.
Extrait de la table des matières
Introduction. Bruno Duriez, directeur de recherche au CNRS, CLERSÉ, Lille
Première partie. Attitudes a l'égard du monde
- Le
militantisme chrétien à l'épreuve de l'idée
missionnaire
- Denis Pelletier, maître de conférences en histoire, Université de Lyon 2
- L'action
catholique et la transformation des modèles d'implication dans
l'espace public
- Éric Belouet, doctorant en histoire, Université de Paris 13
- Joël Morlet, sociologue
- Musulmans
français et intégration socio-politique
- Jocelyne Césari, chargée de recherche au CNRS, GSRL, Paris
- Les
groupes religieux minoritaires: protestation, refus du monde et action
humanitaire
- Régis Dericquebourg, maître de conférences en psychologie sociale, Université de Lille 3
Deuxième partie. Stratégies de visibilité ou de discrétion en catholicisme
- Les
évêques français face au monde moderne : l'exemple
du rapport Dagens
- Christine Pina, maître de conférences de science politique, Université de Nice, CIDSP
- Religieux
et religieuses catholiques dans l'espace public. L'exemple de la France
et du Québec
- Kristoff Talin, chargé de recherche au CNRS, CIDSP, Grenoble
- Paul-André Turcotte, professeur de sociologie, Institut catholique de Paris
- Stratégies
de présence: les prêtres au travail (1944-1965)
- Nathalie Viet-Depaule, ingénieur d'études au CNRS, CEMS, Paris
- Attitudes
religieuses et implications syndicales
- Dominique Andolfatto, maître de conférences de science politique, Université de Nancy 2, GREP
Troisième partie. Visibilité et discrétion des religions minoritaires
- Devenir
des Juifs d'État : de la visibilité à la discrétion
- Pierre Birnbaum, professeur de sociologie, Université de Paris 1
- Ostentation
religieuse et pratiques politiques : le cas du judaïsme sarcellois
- Sylvie Strudel, maître de conférences de science politique, IEP de Lille, CRAPS
- Les
associations protestantes d'entraide, entre charité et solidarité
- Gilbert Vincent, professeur de philosophie, Université de Strasbourg 2, CSRES
Quatrième partie. Religion plurielle et formes d'implication sociale
- L'évolution
des modes d'engagement dans l'espace public
- Jacques Ion, directeur de recherche au CNRS, CRESAL, Saint-Etienne
- Identités
religieuses et pluralité des rapports au monde
- Jean-Marie Donegani, directeur de recherche au CNRS, CEVIPOF, Paris
- La
socialisation politique et religieuse des adolescents en France : permanences
et mutations
- Vincent Tournier, maître de conférences de science politique, IEP de Grenoble, CIDSP
Cinquième partie. Aux frontières du religieux
- Le
soin des âmes et des corps en débat public : l'analyseur
psycho-mystique-ésotérique
- Françoise Champion, chargée de recherche au CNRS, GSRL, Paris
- Valérie Rocchi, docteur en sociologie, Université de Paris 5, CIDSP
- Les
référents "religieux" des "écologistes"
- André Micoud, directeur de recherche au CNRS, CRESAL, Saint-Etienne
- Socialisations
religieuses et formes identitaires dans le champ professionnel
- Claude Dubar, professeur de sociologie, Université de Versailles
Conclusion. Pierre Bréchon, professeur de science politique, IEP de Grenoble, CIDSP